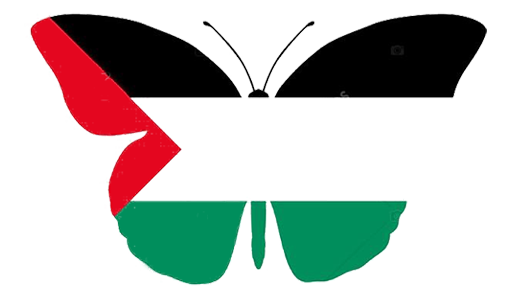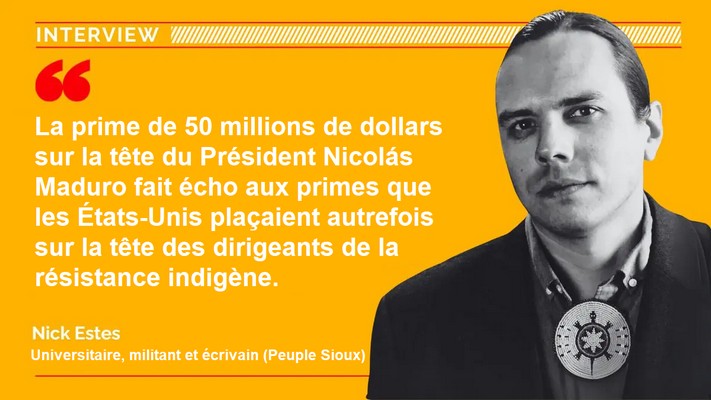Par Cira Pascual Marquina
Membre inscrit de la Communauté Sioux de Lower Brule, l’historien renommé Nick Estes co-anime le podcast The Red Nation. Il est l’auteur de Our History Is the Future: Standing Rock Versus the Dakota Access Pipeline, and The Long Tradition of Indigenous Resistance (Verso, 2019), un ouvrage qui replace la lutte contre un oléoduc dans le contexte de plusieurs siècles de résistance autochtone au colonialisme et à l’impérialisme états-uniens.
Dans cette interview, Estes retrace les continuités entre le colonialisme de peuplement des États-Unis et leurs projets impérialistes dans le monde, soulignant comment les soi-disant « guerres indiennes » ont servi de modèle aux guerres sans fin menées par Washington. Il explique également comment les États-Unis ont pris pour cible à la fois les peuples autochtones sur leur propre territoire et des pays comme le Venezuela, par le biais de la dépossession, de la guerre et des sanctions. Estes aborde à la fois la profondeur de la violence impérialiste états-unienne et l’urgence de forger des liens entre les luttes autochtones, anti-impérialistes, bolivariennes et latino-américaines.
Cira Pascual Marquina – On connait la nature violente, voire exterminatrice de l’impérialisme états-unien envers les peuples et les nations, comme en témoignent clairement le génocide qu’il perpétue en Palestine et les mesures coercitives meurtrières qu’il impose au Venezuela. Cependant, l’impérialisme est également enraciné dans le colonialisme interne, en particulier la dépossession des nations autochtones en Amérique du Nord. Comment les processus impérialistes à l’intérieur des États-Unis reflètent-ils ceux qui se déroulent à l’extérieur ?
Nick Estes – Dans notre hémisphère, deux idéologies clés sous-tendent le colonialisme et l’impérialisme états-uniens : le « destin manifeste » et la doctrine Monroe. La doctrine Monroe est essentiellement une extension du « destin manifeste ».
Lorsque les États-Unis ont été fondés il y a 250 ans, ils ne comptaient que 13 colonies le long de la côte est. En l’espace d’un siècle, ils s’étaient étendus pour s’emparer de plus d’un milliard d’acres de territoire et de possessions outre-mer. Cette expansion a fait progresser le projet d’une nation suprémaciste blanche au détriment des peuples autochtones. La doctrine Monroe a étendu cette même logique à l’ensemble de l’hémisphère.
Nous pouvons voir cette doctrine s’étendre à l’échelle mondiale aujourd’hui, avec la Palestine comme exemple le plus extrême. Quel est le but d’une telle violence ? Il s’agit en partie de terrorisme, d’envoyer un message au monde : voici ce qui arrive si vous résistez à l’Empire ; voici ce à quoi vous pouvez vous attendre si vous essayez de construire votre souveraineté et votre libération.
Israël, un projet sioniste, sert également les intérêts des États-Unis en projetant sa puissance en Asie occidentale, en déstabilisant la souveraineté régionale et, en fin de compte, en ouvrant une « porte dérobée » à la Chine. Cela est étroitement lié au programme de l’administration Trump : guerres tarifaires, ciblage des voisins de la Chine et contrôle des ressources nécessaires aux nouvelles technologies. Rien de tout cela n’est caché : c’est ouvertement déclaré.
Enfin, les guerres en Asie occidentale sont également des avertissements pour cet hémisphère.
La doctrine Monroe a été synonyme de coups d’État et d’interventions dans toute l’Amérique latine. Récemment, au Venezuela, elle s’est traduite par des sanctions dévastatrices et des tentatives de changement de régime dignes de gangsters, notamment une prime de 50 millions de dollars sur la tête de Nicolás Maduro. Il convient de noter que cette « prime » fait écho aux primes que les États-Unis avaient autrefois mises sur la tête des chefs de la résistance indigène. En bref, les attaques actuelles contre le Venezuela, Cuba et le Nicaragua sont la continuation des guerres autrefois menées contre les nations autochtones sur le territoire actuel des États-Unis.
Alors que l’encre de la Constitution était encore fraîche, George Washington a mené une guerre sanglante contre la Confédération du Nord-Ouest des nations autochtones. Cela a marqué le début de plus d’un siècle de guerres dites « indiennes » : quatorze conflits majeurs marqués par le génocide et la dépossession. Les effets se font encore sentir aujourd’hui.
Les États-Unis utilisent ces guerres comme banc d’essai pour leurs « guerres éternelles » actuelles. Par exemple, lorsque Trump a bombardé les installations nucléaires iraniennes, il l’a fait en vertu de la même autorité que le premier président, George Washington, qui a mené la guerre en 1790 contre les nations autochtones sans déclarer officiellement la guerre ni demander l’approbation du Congrès. Après la Seconde Guerre mondiale, cette logique a été étendue aux guerres en Corée, au Vietnam, en Irak, en Afghanistan, en Syrie et au-delà. C’est ainsi que les guerres dites « indiennes » sont devenues un modèle pour une guerre mondiale permanente.
Cira Pascual Marquina – En Amérique du Nord comme en Amérique du Sud, le colonialisme s’est transformé en impérialisme. Nous partageons une histoire de dépossession. Considérez-vous que ce passé commun – et nos luttes actuelles – rapprochent nos peuples ? Je pose cette question parce que les mouvements autochtones aux États-Unis luttent pour la terre, la souveraineté et l’autodétermination, qui sont également les piliers centraux de la révolution bolivarienne.
Nick Estes – Je voudrais répondre en me référant à l’histoire récente. Aux États-Unis, les peuples autochtones sont racialisés par l’effacement. Nous sommes souvent considérés comme des reliques historiques plutôt que comme des communautés politiques vivantes – le colonialisme continue de façonner notre réalité quotidienne. Dans le Dakota du Sud, d’où je viens, l’espérance de vie des autochtones n’est que de 59 ans, soit près de deux décennies de moins que celle des Blancs.
Donc oui, nous luttons pour la terre, la souveraineté et l’autodétermination, qui ne sont pas des idées abstraites pour nous. Elles sont tangibles car elles améliorent nos chances dans la vie.
Il y a un demi-siècle, le mouvement Red Power s’est internationalisé, établissant des relations avec le Nicaragua, l’Organisation de libération de la Palestine et d’autres organisations révolutionnaires à travers le monde. Plus récemment, en 2007, Vernon Belcourt, un leader de l’American Indian Movement, a rendu visite à Chávez pour mettre en place un programme Citgo qui fournissait une aide au chauffage aux nations tribales. Ma tribu a bénéficié de ce programme, c’est ainsi que j’ai découvert le commandant Chávez et la révolution bolivarienne.
Quelques années plus tard, à Standing Rock, lorsque les gens nous ont demandé pourquoi nous nous opposions au Dakota Access Pipeline, la militante Winona LaDuke a expliqué que notre lutte contre le pipeline était également un rejet des sanctions des États-Unis contre le Venezuela et ses plus grandes réserves de pétrole au monde. En d’autres termes, le pipeline, conçu pour transporter l’un des pétroles les plus polluants au monde, était directement lié à l’objectif de l’Empire d’écraser le Venezuela. Des liens internationalistes se sont tissés au cours de la lutte. Les médias locaux n’ont pas compris cela, mais les mouvements autochtones savaient que les luttes étaient liées.
Aux États-Unis, nous sommes également confrontés à une lutte interne. La souveraineté tribale peut s’aligner soit sur l’impérialisme – parfois par le biais de courants réactionnaires liés à Trump – soit sur l’anti-impérialisme et la solidarité avec les luttes des peuples opprimés à travers le monde. L’histoire montre que s’aligner sur l’impérialisme a toujours été désastreux pour les peuples autochtones.

Hugo Chávez et un membre du peuple Pemón. La Constitution bolivarienne représente un avant et un après pour les peuples autochtones. Cependant, il reste encore des tâches à accomplir. (Prensa Latina)
Cira Pascual Marquina – En 2019, vous vous êtes rendu au Venezuela avec une délégation de jeunes autochtones états-uniens. Vous y êtes retourné en 2020 et 2021. Pouvez-vous nous faire part de certaines de vos expériences ?
Nick Estes – Lorsque j’ai visité l’État de Bolívar [sud du Venezuela], j’ai été très impressionné par la résistance des communautés autochtones, en particulier celle des Pemón, qui se sont ouvertement et explicitement identifiées comme chavistes, affirmant faire partie du projet révolutionnaire.
Certaines des personnes avec lesquelles j’ai discuté avaient suivi une formation officielle de spécialistes de la santé communautaire, combinant leurs connaissances autochtones en matière de guérison et de médecine avec la science occidentale. La Constitution bolivarienne le permet, et favorise la protection des pratiques traditionnelles jusqu’au stade de la participation politique.
Dans les communautés autochtones, les gens votent souvent par consensus et, dans certains cas, sans scrutin secret, conservant ainsi leurs pratiques fondamentales basées sur l’assemblée. Il s’agit là de protections constitutionnelles dont nous, en tant que peuple autochtone aux États-Unis, ne bénéficions tout simplement pas.
En outre, la Constitution vénézuélienne ne se contente pas de protéger ces pratiques, elle garantit également la représentation des autochtones à l’Assemblée nationale. En revanche, les peuples autochtones des États-Unis ne bénéficient d’aucune représentation garantie au Congrès et ne disposent pas de protections constitutionnelles comme celles qui existent au Venezuela. On nous dit souvent que la situation est meilleure aux États-Unis, mais sur le plan constitutionnel et politique, les peuples autochtones du Venezuela sont beaucoup plus intégrés au projet national.
Bien sûr, le processus vénézuélien n’est pas parfait : il y a une lutte permanente et des demandes persistantes de réformes juridiques et constitutionnelles, qui, d’après ce que je comprends, pourraient bientôt voir le jour. Cependant, les sanctions sapent directement ces efforts. Si nous sommes des internationalistes engagés, la première étape consiste à œuvrer pour la levée des sanctions, afin de permettre aux peuples autochtones et à tous les Vénézuéliens de poursuivre leur autodétermination dans le cadre bolivarien.
Cira Pascual Marquina – Nous avons vu des moments de solidarité réciproque : le programme de chauffage de Chávez pour les nations tribales et la reconnaissance par Standing Rock du préjudice infligé par les États-Unis au Venezuela n’en sont que deux exemples. Pourtant, l’établissement de liens plus profonds et durables reste une tâche inachevée. Étant donné que le projet communautaire vénézuélien s’inspire des traditions autochtones et que les peuples autochtones des États-Unis continuent de lutter pour faire avancer les efforts de construction communautaire, la question qui se pose est la suivante : comment pouvons-nous renforcer ces liens ?
Nick Estes – En Amérique du Nord, même au sein des mouvements autochtones, il existe parfois une réticence à s’associer aux luttes internationales. Les écologistes libéraux, par exemple, tentent souvent de faire taire ces liens. Mais nous avons tout à fait le droit de nouer des relations avec des mouvements à travers le monde, tout comme l’a fait le mouvement amérindien à la fin des années 60 et dans les années 70.
Lorsque j’ai rendu visite à la communauté Kaika Shi à Caracas, une matriarche nous a dit : « Le premier ennemi, c’est le capitaliste qui est dans votre tête. N’attendez pas que quelqu’un d’autre résolve vos problèmes, vous devez les résoudre ici et maintenant ! » Ses paroles ont profondément touché les jeunes autochtones qui m’accompagnaient. Aux États-Unis, nous souffrons souvent de « programmite » : il existe des programmes pour tout, mais les crises liées à la toxicomanie, au suicide et à la pauvreté persistent. Les programmes seuls ne suffisent pas à démanteler le colonialisme. C’est l’autodétermination qui le fait.
Les délégations comme la nôtre sont cruciales. Il est difficile pour les Vénézuéliens de se rendre aux États-Unis, mais les échanges sont nécessaires. Trop souvent, les peuples autochtones des États-Unis intériorisent le chauvinisme et rejettent les autres luttes. Mais lorsqu’ils rencontrent leurs camarades vénézuéliens, boliviens ou cubains en face à face, ils voient immédiatement les liens qui les unissent.
Je me souviens qu’un jeune délégué m’a dit quelque chose de très significatif : « Le Venezuela est une grande réserve ». Il voulait dire deux choses : premièrement, que le Venezuela est assiégé par les États-Unis ; deuxièmement, que, comme une réserve, le Venezuela a un esprit communautaire où tout le monde se connaît et lutte ensemble.
C’est quelque chose que l’on ne peut vraiment comprendre qu’en rencontrant des personnes qui construisent activement le monde que nous voulons tous. Les Vénézuéliens ne nous ont jamais dit : « Copiez notre modèle ». Au contraire, ils nous ont toujours dit : « Faites votre révolution chez vous. Construisez d’abord la dignité de votre peuple, tout en vous alliant au processus bolivarien ».

Traduction de l’anglais : Thierry Deronne
Source : Le blog de Thierry Deronne
https://venezuelainfos.wordpress.com/…
Notre dossier États-Unis
Notre dossier Venezuela