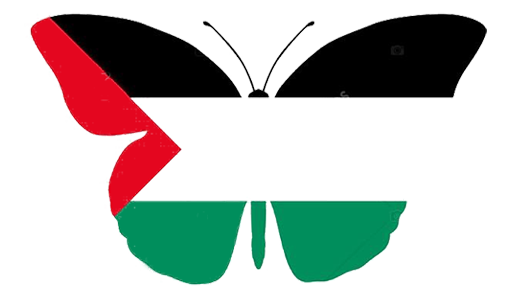Le président Donald Trump, à gauche, accueille le président ukrainien Volodymyr Zelensky à son arrivée à la Maison-Blanche, le lundi 18 août 2025, à Washington. [AP Photo/Alex Brandon]
Par Peter Schwarz
Source : WSWS
Il n’existe aucun précédent historique pour la réunion au sommet qui a eu lieu à Washington lundi. Avec seulement 24 heures de préavis, les chefs de gouvernement des quatre pays européens les plus puissants économiquement, la présidente de la Commission européenne et le secrétaire général de l’OTAN se sont rendus dans la capitale américaine pour soutenir le président ukrainien Zelensky lors de sa rencontre avec le président américain Trump.
Un tel rassemblement de hauts responsables politiques ne survient généralement que lors de funérailles nationales, à l’exception des sommets réguliers préparés des mois à l’avance. La réunion de Washington est peut-être en réalité le prélude à des funérailles : celles de l’OTAN, qui façonne les relations transatlantiques depuis 76 ans.
La façade étrange de la rencontre – l’adulation et les gestes d’humilité envers Trump, les efforts désespérés des Européens pour afficher un front uni, les assurances de leur entente et de leur unique volonté de paix – dissimulait les profondes fissures au sein de l’alliance atlantique. En réalité, les désaccords n’ont jamais été aussi marqués.
Tandis que les dirigeants européens se prosternaient devant Trump, une figure méprisée à travers le monde, comme dans une comédie de Molière, ils pouvaient voir les soldats lourdement armés devant la Maison-Blanche, que Trump avait fait venir dans la capitale pour démontrer : « Ici, c’est moi le dictateur. »
Ce qui a poussé les dirigeants européens à écourter leurs vacances et à se précipiter à Washington, c’est la crainte que Trump ne conclue un accord avec le président russe Poutine à leur détriment.
Depuis des années, ils ont investi d’énormes ressources dans l’armement de l’Ukraine et dans l’intensification de la pression sur la Russie. Ils ont diabolisé le président russe Poutine en tant qu’incarnation du mal, avec qui il serait impossible de négocier puisqu’il ne comprendrait que la force.
Ils pensaient être en accord avec les États-Unis, du moins tant que Joe Biden était à la Maison-Blanche. Selon les chiffres de l’Institut de Kiel (IFW), l’Europe a soutenu l’Ukraine à hauteur de 167 milliards d’euros d’aide militaire et financière depuis le début de la guerre il y a trois ans et demi, et a promis 90 milliards supplémentaires. Les États-Unis ont versé 114 milliards d’euros et en ont promis 4 de plus.
Les États-Unis ont été, au départ, la force motrice. Même l’Allemagne, le plus grand donateur à l’Ukraine après les États-Unis, a longtemps hésité à cesser d’acheter du gaz naturel bon marché à la Russie, jusqu’à ce que la pression américaine et la destruction des gazoducs Nord Stream ne lui laissent plus d’autre choix.
Mais désormais, Trump opère un virage brutal de la politique étrangère américaine. Vendredi, il a accueilli Poutine à bras ouverts en Alaska et s’est entendu sur l’ouverture de négociations pour mettre fin à la guerre. Trump espère que cela lui permettra d’accéder à des matières premières stratégiques en Russie et en Ukraine, d’affaiblir ses rivaux européens contre lesquels il a déjà imposé des tarifs punitifs, et de saper l’alliance entre la Russie et la Chine. Les États-Unis pourraient ainsi concentrer encore plus leurs forces militaires sur une préparation à la guerre contre la Chine.
Depuis la rencontre entre Trump et Poutine, les lignes de communication entre Kiev, Bruxelles, Berlin, Paris et Londres bourdonnent. Les Européens se sentent trahis. Leur but de mettre l’Ukraine et la Russie sous leur contrôle grâce au soutien des États-Unis s’est révélé être une erreur de calcul désastreuse.
Les puissances impérialistes européennes sont encore trop faibles militairement pour poursuivre la guerre contre la Russie sans le soutien des États-Unis. L’Ukraine, qui a récemment subi d’importantes pertes territoriales, souffre d’un manque de soldats et le sentiment de la population change. Selon un récent sondage Gallup, 69% des Ukrainiens sont favorables à une paix négociée rapide, contre seulement 24% souhaitant continuer la guerre. Il y a trois ans, la tendance était inversée.
Dans ces conditions, les puissances européennes tentent d’influencer Trump, dont la politique fait également débat aux États-Unis, en leur faveur. Le voyage à Washington avait ce but. S’ils n’arrivaient pas à empêcher Trump de se retirer de la guerre, l’Ukraine devrait au moins être transformée en une forteresse lourdement armée pour maintenir la pression sur la Russie.
Cependant, la rencontre n’a débouché sur aucun accord. Les dirigeants européens considéraient déjà comme un succès qu’il n’y ait eu aucun scandale et qu’ils n’aient pas été expulsés de la Maison-Blanche comme l’a été Zelensky il y a six mois. « Cela aurait pu se passer bien différemment », a commenté le chancelier allemand Friedrich Merz.
Lorsqu’en face des caméras, Merz a répété la demande européenne exigeant que la Russie accepte un cessez-le-feu avant toute négociation, Trump l’a sèchement écarté. « Je le répète, dans les six guerres que j’ai réglées, il n’y a jamais eu de cessez-le-feu », a-t-il répondu.
Les puissances européennes ont repris espoir lorsque Trump et son envoyé spécial Steve Witkoff ont annoncé que Poutine était prêt à accepter des garanties de sécurité occidentales pour l’Ukraine et que les États-Unis soutiendraient de telles garanties sous une forme ou une autre. Mais il est rapidement devenu évident que la notion de « garanties de sécurité » est interprétée de manière radicalement différente.
Trump a déjà rejeté l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN. Une clause de défense mutuelle pour l’Ukraine, semblable à celle dont bénéficient les membres de l’OTAN en vertu de l’article 5, est à l’étude. Mais elle n’aurait que peu de valeur si elle ne s’accompagnait pas d’un soutien militaire réel.
Le président français Macron et le premier ministre britannique Starmer plaident depuis longtemps pour le déploiement d’une « force de maintien de la paix » occidentale en Ukraine afin de dissuader la Russie. Macron l’a répété à la BBC après la réunion de Washington : « Nous devrons aider l’Ukraine avec des soldats sur le terrain. »
Mais ni la France ni le Royaume-Uni ne peuvent mobiliser aisément les milliers de soldats nécessaires pour une force solide. Pour la première fois, le chancelier Merz a laissé entendre que la Bundeswehr allemande pourrait également participer. Mais elle n’en a pas non plus les moyens, et l’opposition à de tels projets est immense.
Les États-Unis refusent d’engager leurs propres troupes en Ukraine. Le président Trump l’a confirmé de nouveau sur Fox News après la réunion à Washington. Ni les États-Unis ni l’OTAN ne participeraient à une telle force, dit-il. Si elle devait exister, elle devrait être fournie par les pays européens.
On évoque également une « force de déclenchement » composée d’un nombre restreint de soldats, qui entraînerait une intervention de l’OTAN en cas de confrontation avec la Russie. Une troisième option serait une simple force d’observation, qui aurait du mal à être acceptée comme « garantie de sécurité » par l’Ukraine et ses alliés les plus proches.
Il est difficile d’imaginer que la Russie accepte le déploiement de troupes occidentales sur le sol ukrainien sous quelque forme que ce soit, étant donné que l’avancée de l’OTAN vers l’est était la raison de l’invasion russe de l’Ukraine. La demande de « soldats sur le terrain » vise donc aussi à saboter une solution négociée et à prolonger la guerre. Macron l’a confirmé en déclarant à NBC que les informations selon lesquelles l’Ukraine serait en train de perdre la guerre étaient des « fake news totales ».
Une autre proposition sur la façon dont l’Ukraine pourrait obtenir des « garanties de sécurité » des États-Unis est venue de Kiev. Le gouvernement ukrainien a proposé d’acheter pour 100 milliards de dollars d’armes américaines et de fabriquer conjointement avec les États-Unis des drones pour 50 milliards. Ce serait à l’Europe de payer l’achat d’armes. La proposition figurait dans un document préparé pour le sommet de Washington, cité par le Financial Times.
Pour les puissances européennes, cela reviendrait à financer une Pax Americana qui les exclurait et saperait leurs efforts de développement de leur propre industrie d’armement.
La classe ouvrière ne doit soutenir aucun camp dans ce conflit. Un accord entre Trump et Poutine ne constituerait pas un pas vers la « paix », mais une nouvelle escalade vers une troisième guerre mondiale, principalement dirigée contre la Chine et également poursuivie au Moyen-Orient. De leur côté, les Européens sont déterminés à poursuivre la guerre contre la Russie en Ukraine, qui a déjà fait des centaines de milliers de victimes et menace de basculer en confrontation directe avec la Russie, une puissance nucléaire.
Ces deux issues impliquent de gigantesques attaques contre les droits sociaux et démocratiques de la classe ouvrière. Aux États-Unis, Trump est en train de mettre en place une dictature autoritaire, tandis qu’en Europe, les élites au pouvoir répriment l’opposition à la guerre et au militarisme, et font payer à la population le coût colossal du réarmement.
La résistance à la guerre et au militarisme va de pair avec la lutte contre les coupes sociales, les licenciements et la dictature. La menace de guerre ne pourra être arrêtée que par un mouvement de la classe ouvrière internationale luttant indépendamment pour renverser le capitalisme et instaurer une société socialiste.
Source : WSWS
https://www.wsws.org/fr/…
Notre dossier États-Unis
Notre dossier OTAN
Notre dossier Russie
Notre dossier Ukraine