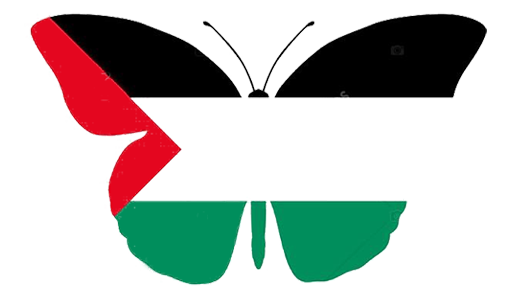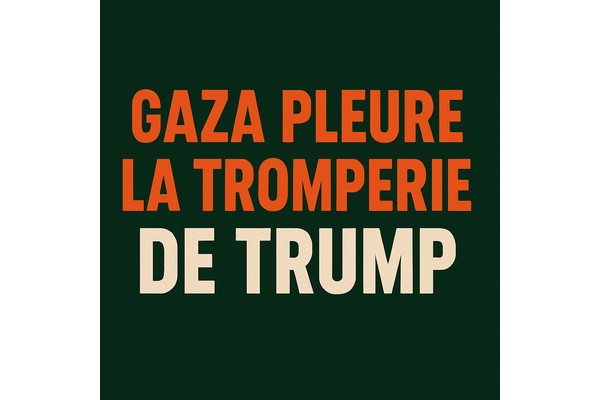Par Kader Tahri
Peu importe le flacon, pourvu qu’on ait l’ivresse, dit le proverbe.
Dans le cas de Trump, ses moyens d’obtenir une paix sont originaux : c’est un cocktail fait de séduction, de pression et de chantage. Mais la realpolitik, c’est ça. Donald Trump se présente à nouveau en faiseur d’accords, maître des « deals » capables, dit-on, de résoudre les impasses les plus inextricables. Son dernier plan pour Gaza, brillamment emballé dans le vocabulaire consensuel de la « paix » et de la « reconstruction », montre pourtant que la rhétorique peut servir d’écran de fumée : derrière le mot se cachent des conditions intenables, une mémoire sélective et la perpétuation d’un ordre de fait qui écrase les droits palestiniens.
La « paix » comme instrument de culpabilisation
Le dispositif proposé reconstruction financée par des États arabes, démilitarisation du Hamas, retrait israélien conditionnel ressemble à une logique de marché : on promet la tranquillité à ceux qui acceptent de perdre tout levier politique. Mais poser la paix comme synonyme de reddition, c’est inverser les responsabilités. On demande à un peuple déjà affamé, déplacé et bombardé d’abandonner son unique moyen de pression, sans garantir ni sécurité réelle ni rétablissement des droits fondamentaux.
En traitant Gaza comme une entité isolée, comme si la Cisjordanie et l’ensemble de l’occupation n’existaient pas, ce plan gomme les continuités historiques du conflit : colonies qui s’étendent, frontières de 1967 bafouées, confiscation progressive de Jérusalem-Est. Ce n’est pas un oubli anecdotique : c’est la stratégie même du projet politique que prétend soutenir l’initiative. La paix proposée devient alors une paix sur ordonnance, imposée au plus faible.
Ultimatums et rhétorique du chantage
Dire « paix » tout en fixant des ultimatums de 72 heures et en conditionnant la cessation des hostilités à l’accord des seules parties déséquilibrées, c’est ménager un prétexte pour continuer la guerre. La diplomatie coercitive masque la réalité : les bombardements et les sièges se poursuivent tant que l’autre camp n’a pas capitulé. Ce n’est plus de la négociation ; c’est du chantage.
L’effet est double : d’un côté, il légitime l’usage disproportionné de la force ; de l’autre, il transforme la communauté internationale en spectatrice d’une mise à mort programmée, applaudissant parfois le verbe « paix » sans en exiger les conditions préalables — la justice, la reconnaissance des droits et la cessation des pratiques qui nourrissent le conflit.
Les membres du Hamas ne sont pas assez débiles pour déposer les armes face à des gens qui pendant 2 ans de génocide n’arrêtent pas de leur dire que le but de tout ça c’est le grand Israël, leur expulsions ou leur massacres de la terre de Palestine, qu’ils sont le peuple des ténèbres et qu’on a le droit de les exterminer et que leur but c’est la domination des goyims. Sans Hamas et dans l’état de Gaza et les nouvelles colonisations, il n’y a plus de Palestine
Mémoire instrumentalisée : otages et prisonniers
Le récit médiatique et politique est tout aussi révélateur. L’attention portée aux otages israéliens est légitime et humaine, mais elle devient partiale quand elle occulte le sort de milliers de prisonniers palestiniens détenus souvent sans procès ou sous des régimes de détention administrative et quand elle efface l’histoire de la dépossession. Cette asymétrie contribue à une narration dans laquelle la victime légitime est une seule, alors que la victimisation et la douleur existent de part et d’autre, entretenues par des rapports de force inégaux.
Rappelons que des opérations visant à capturer des otages ont été, dans certains cas, conçues comme leviers pour obtenir des échanges de prisonniers. Depuis, combien de détenus palestiniens ont été libérés ? Le silence et l’oubli autour de ces questions renforcent l’impunité et l’angoisse d’un peuple sans recours.
Le levier essentiel : arrêter l’armement et la protection inconditionnelle
S’il existe un geste unique, simple et efficace, qui pourrait signifier la sincérité d’une volonté de paix, c’est l’arrêt immédiat des livraisons d’armement et des financements militaires sans condition. La pression économique et diplomatique pèse. Quand un pays garantit politiquement et militairement la supériorité d’un acteur, il devient co-responsable des choix stratégiques et des conséquences sur le terrain.
Les Etats qui prétendent défendre la paix doivent cesser de conforter les rapports de force qui permettent la perpétration d’actes contraires au droit international. La paix ne se négocie pas sur le compte en banque des victimes ni sur la base d’accords imposés par un tiers qui refuse de regarder les causes profondes du conflit.
Justice et droits : préalables non négociables
Toute initiative qui ignore la justice se condamne à l’échec. La sortie de crise exige des engagements clairs : fin de l’occupation, respect des frontières internationalement reconnues, reconnaissance des droits civils et politiques des Palestiniens, garantie de la sécurité pour toutes les populations, procès des crimes de guerre et libération des détenus politiques. Sans ces éléments, les accords n’auront qu’une valeur provisoire et seront à la merci du prochain revirement politique.
La paix durable est indissociable de l’égalité des droits. Tant que des populations seront privées de dignité, de terre et de liberté, la violence trouvera des raisons de renaître.
Conclusion : refuser la paix-cache-misère
La « diplomatie-spectacle » ne suffira jamais à résoudre des injustices structurelles. Proposer la paix en demandant l’effacement de la mémoire, l’abandon des droits et la capitulation du faible, c’est fabriquer un simulacre qui se paiera en vies humaines. Il est urgent que la communauté internationale reprenne ses responsabilités : exiger la fin de l’occupation, conditionner toute aide militaire au respect du droit international et soutenir des mécanismes de justice impartiale.
Les mots « paix » et « sécurité » ne doivent pas servir d’alibis. Ils doivent être adossés à des actes réels et vérifiables. Sinon, nous ne bâtirons que des accords fragiles, des pauses temporaires dans une logique de violence qui reprendra, un jour ou l’autre, sous une autre forme. La vraie question n’est pas de savoir qui signe le prochain « deal », mais qui aura le courage de défendre la justice la seule condition pour qu’enfin, paix et dignité se conjuguent pour tous.
Kader Tahri
Chroniqueur engagé, observateur inquiet
« Il faut dire les choses comme elles sont, mais refuser qu’elles soient comme ça. »
Source : auteur
Notre dossier États-Unis
Notre dossier Palestine