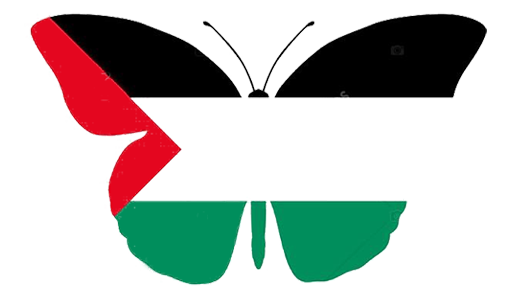Conversations de Salim Lamrani avec Bruno Guigue
Normalien et énarque, chercheur en philosophie politique, Bruno Guigue a été haut fonctionnaire pendant près de vingt ans. Il s’est ensuite consacré à la recherche en sciences politiques et a publié dix ouvrages ainsi que de nombreux articles traduits en plusieurs langues. Il est aujourd’hui professeur invité à l’Université normale de la Chine du Sud (Canton) et chargé de cours à l’Institut Confucius de La Réunion. Il est considéré comme l’un des meilleurs spécialistes français de la Chine.
Dans son dernier livre, L’Odyssée chinoise, de Mao Zedong à Xi Jinping, il retrace l’expérience historique unique de la République populaire de Chine et analyse la stratégie mise en œuvre par les autorités pour sortir le pays du sous-développement et atteindre un indice de développement humain comparable à celui des nations les plus avancées. Première économie mondiale en parité de pouvoir d’achat, première puissance industrielle et commerciale, la Chine construit aujourd’hui des infrastructures dans près de 150 pays.
Dans ces conversations, Bruno Guigue retrace l’histoire de la Chine. Il revient la situation du pays avant la Révolution maoïste de 1949 et évoque le parcours de Mao Zedong ainsi que la naissance du Parti communiste chinois. Il explique en détail la conquête du pouvoir et les grandes étapes du processus révolutionnaire. Il précise les spécificités du socialisme chinois, rappelant que l’État détient le contrôle des trois grandes sources de capital. Il mentionne également la lutte contre la grande pauvreté, tout en soulignant l’existence d’inégalités, atténuées par un système de sécurité sociale très protecteur.
Bruno Guigue passe ensuite en revue diverses grandes questions : situation démographique, crise immobilière et protection de l’environnement. Il n’élude pas les sujets controversés, tels que la question de la démocratie, des élections, de la liberté d’expression, des droits de l’homme, des Ouighours et des prisonniers politiques. Il aborde enfin le statut de « puissance pacifique » de la Chine, sa place sur la scène internationale, ses relations avec les États-Unis, le projet « une ceinture, une route », ses liens avec le Sud global et la question de Taiwan.
Salim Lamrani : Quelle était la réalité de la Chine avant la Révolution maoïste de 1949 ?
Bruno Guigue : Avant 1949, la Chine était un pays complètement dévasté par la guerre. Après l’effondrement de la dynastie Qing en 1911, une succession de péripéties secoue le pays : l’affrontement entre les seigneurs de la guerre, la tentative de Tchang Kaï-chek de fonder un État stable durant la fameuse « décennie de Nankin » de 1927 à 1937, la première guerre civile opposant nationalistes et communistes, la création d’un front uni à partir de 1937 pour mener la lutte commune contre les Japonais jusqu’en 1945, puis la reprise de la guerre civile entre communistes et nationalistes de 1946 à 1949, Tchang Kaï-chek ayant refusé le partage du pouvoir.
Durant la guerre contre le Japon, le Parti communiste avait gagné en influence, car il avait rallié à sa cause une partie des paysans pauvres. En 1945, la Chine reste un pays agraire où 90% de la population vit dans les campagnes, dans une pauvreté extrême. Certains paysans en viennent même à vendre leur fille ou leur épouse, faute de pouvoir les nourrir. Près de 85% des Chinois ne savent ni lire, ni écrire, ni compter, alors que la Chine est une civilisation plurimillénaire où l’écriture joue un rôle central. Toutes les infrastructures sont détruites. L’agriculture est en piteux état, manquant d’équipements, d’outillage et de semences. Quant à l’industrie, elle est réduite à néant.
En un mot, la situation de la Chine en 1949 est catastrophique. L’ONU, qui venait d’être fondée, estime que le revenu par habitant y est inférieur à celui de l’Afrique subsaharienne, et même inférieure à celui de l’Inde, devenue indépendante en 1947. La Chine est alors le pays le plus pauvre de la planète, et elle ne va renaître de ses cendres que grâce à la Révolution socialiste initiée par le Parti communiste chinois. Ce processus a été long et douloureux, marqué par un parcours sinueux vers la libération, dont Mao Zedong a pris la tête à partir de la fondation de PCC en 1921.
Entretien complet ici : https://journals.openedition.org/etudescaribeennes/37422
Source : Salim Lamrani
Notre dossier Chine