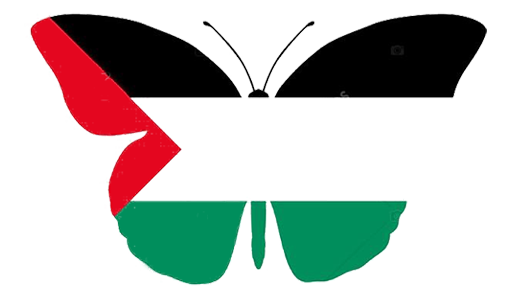Photo aérienne de Rafah, après l’urbicide commis par l’armée israélienne (juin 2025)
Par Ryan Tfaily & Caterina Bandini
Source : YAANI
Par Ryan Tfaily, étudiant en M2 à l’EHESS (École des Hautes Études en Sciences Sociales), stagiaire au sein de Yaani, et Caterina Bandini, docteure en sociologie, ATER à l’Université de Lille et membre du comité de rédaction de Yaani.
Comment expliquer le consentement ou l’indifférence au génocide à Gaza, qui a prévalu dans de larges pans des sociétés occidentales depuis bientôt deux ans ? À cette question, nous proposons de répondre en étudiant les médiatisations successives de la mise à mort des Palestinien·nes dans l’espace public français. Trois grammaires, banales mais puissamment anesthésiantes, ont été investies par les discours officiels afin de traiter de la destruction de Gaza : militaire, diplomatique, humanitaire. En se superposant et en effaçant le lexique – puis les actes – génocidaires d’Israël, ces trois façades discursives ont activement participé à rationaliser le crime de masse à l’œuvre sur le terrain. L’analyse des étapes de cette « raison génocidaire » invite à déconstruire la césure arbitrairement établie, par les discours hégémoniques, entre un « moment juste » et un « moment injuste » de la guerre à Gaza, le second étant censé avoir débuté en mars 2025. Fabrication du langage, cette rupture éclaire moins une prétendue escalade des actes génocidaires là-bas, qu’une difficulté croissante à les rationaliser ici.
« Le fait qui, sans doute, hantera le plus durablement les mémoires, y compris peut-être en Israël, est la manière dont l’inégalité des vies a été donnée à voir sur la scène de Gaza et dont elle a été ignorée par les uns, légitimée par les autres. […] Il n’est guère d’exemple où les gouvernements des pays occidentaux détournent aussi ostensiblement le regard jusqu’à trouver une justification [à l’inégalité des vies] et réduire au silence les voix qui la critiquent. »
Didier Fassin, Une étrange défaite. Sur le consentement à l’écrasement de Gaza, 2024, p. 111.
Depuis bientôt deux ans, beaucoup d’encre a coulé dans la tentative d’expliquer l’inexplicable : le consentement généralisé, dans les sociétés occidentales, à l’anéantissement de Gaza par l’État d’Israël. Certain·es ont pointé le retour du refoulé colonial dans les sociétés européennes, ainsi que l’islamophobie, le racisme anti-arabe et anti-palestinien qui, en France notamment, ont contribué à faciliter l’approbation ou l’indifférence au génocide en cours. Didier Fassin s’est attelé à constituer les prémices d’une archive sur ce qu’il considère comme une « immense béance dans l’ordre moral du monde ». Le professeur au Collège de France affirme que le soutien apporté par les gouvernements occidentaux, les médias dominants et de nombreux·ses intellectuel·es à l’écrasement de Gaza relève d’une « trahison des mots ».
La question du langage que pose Didier Fassin s’avère être un enjeu indispensable à la compréhension du consentement de masse. Dans le cas de Gaza, elle est l’est d’autant plus que le récit du génocide repose sur un paradoxe discursif, relevé dès le 13 octobre 2023 par Raz Segal, historien israélien et spécialiste de la Shoah : « Israël a été explicite à propos de ce qu’il s’apprête à commettre à Gaza. Pourquoi le monde n’écoute-t-il pas ? ». D’un côté, les responsables politiques et militaires, en Israël, n’ont cessé d’afficher leurs intentions éradicatrices ; de l’autre, les discours hégémoniques, en France notamment, n’ont cessé de les nier. Comment comprendre une telle dissonance ? Est-ce dû, comme le suggère Raz Segal, à un problème de surdité ?
Cet article propose d’explorer l’hypothèse selon laquelle les espaces publics officiels occidentaux ont bien « écouté » le répertoire discursif génocidaire en provenance d’Israël, mais se sont efforcés de le rationaliser, en le convertissant en trois régimes de discours socialement acceptables : militaire, diplomatique, puis humanitaire. Ces trois langages, qui se sont superposés au champ lexical génocidaire israélien, ont été plus banals – mais tout aussi puissants – et ont participé de la production du consentement de masse, tout en passant sous les radars de l’analyse critique. Ils ont suivi un ordre quasi chronologique à l’effacement progressif de Gaza.
La guerre a d’abord été présentée par les discours politiques et médiatiques comme juste, ses conséquences humanitaires comme regrettables mais inévitables, et sa résolution comme devant être le fait d’une « négociation » entre les deux parties.
Or depuis mars 2025, ces paradigmes guerrier et diplomatique se sont effondrés : les conséquences humanitaires qui étaient jusque-là considérées comme des « dégâts collatéraux » sont soudainement apparues, dans ces mêmes discours, comme trop imposantes, trop choquantes, injustifiables. La capacité des diplomaties occidentales et des médias à rationaliser les crimes israéliens a perdu de son élan.
L’humanitarisation du génocide est alors venue produire une nouvelle forme de rationalisation. Elle a induit une rupture entre un « moment guerrier » licite et un « moment inhumain » illicite, la frontière entre les deux ayant été établie arbitrairement par les discours médiatiques et politiques. D’une nouvelle manière, cette grammaire humanitaire occulte la dimension profondément politique de ce qui est en cours à Gaza : la réduction intentionnelle, par Israël et ses alliés, des Palestinien·nes à une vie impossible pour tuer leur projet et leur conscience politique. Finalement, qu’elle soit militaire, diplomatique ou humanitaire, la rationalisation a fonctionné comme une mise en scène masquant l’avancement inexorable d’un fait désormais accompli : l’écrasement de Gaza.
/…
La suite sur YAANI
https://www.yaani.fr/…
Notre dossier Palestine