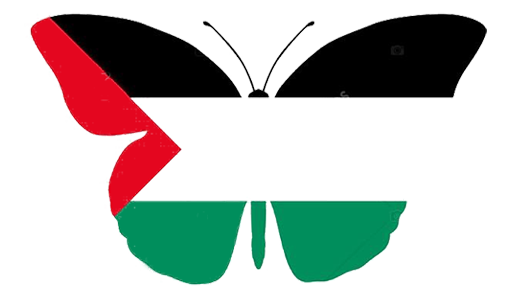Par Kader Tahri
Sous couvert de sécurité et de lutte contre le terrorisme, Israël poursuit une campagne militaire d’une brutalité sans précédent contre Gaza, au mépris du droit international. Pendant que les chancelleries occidentales détournent le regard, la presse rebaptise les violations de trêve en simples “tests”. Derrière cette novlangue se cache une impunité devenue systémique — et une tragédie humaine que le silence du monde rend possible
Quelques jours à peine après l’annonce d’un cessez-le-feu présenté comme un “pas vers la paix”, Gaza a de nouveau été frappée. Selon plusieurs témoins locaux et ONG humanitaires, l’armée israélienne aurait ouvert le feu après qu’un véhicule militaire a roulé sur un obus non explosé — issu de ses propres bombardements massifs. L’explosion, immédiatement imputée au Hamas, a servi de justification à une nouvelle vague de frappes sur l’enclave, faisant des dizaines de morts parmi les civils.
L’aide humanitaire, déjà limitée, a été à nouveau suspendue. L’électricité et l’eau sont rationnées. Les hôpitaux, débordés, fonctionnent à flux tendu dans des conditions sanitaires désastreuses. À Gaza, chaque cessez-le-feu ressemble à une parenthèse précaire avant la reprise des bombardements — une pause, jamais une paix.
Et pourtant, dans la plupart des médias occidentaux, cet épisode n’a pas été décrit comme une violation du cessez-le-feu, mais comme un “test” de sa solidité. Une sémantique révélatrice : dans le lexique diplomatique occidental, la vie palestinienne n’est plus un enjeu moral, mais un paramètre d’évaluation stratégique.
La normalisation de la violence
Depuis plusieurs années, la couverture médiatique du conflit israélo-palestinien s’est figée dans un récit déséquilibré. Les bombardements israéliens sur Gaza sont décrits comme des “opérations ciblées” ou des “ripostes”, même lorsqu’ils frappent des écoles, des hôpitaux ou des camps de réfugiés.
En revanche, chaque roquette artisanale tirée depuis Gaza est présentée comme une menace existentielle pour l’État hébreu.
Ce déséquilibre narratif contribue à la normalisation de la violence israélienne : tuer des Palestiniens devient une routine militaire, un bruit de fond de l’actualité. Les violations répétées du droit international ne sont plus scandaleuses ; elles deviennent attendues, presque acceptées.
Ainsi, lorsqu’Israël rase un quartier de Gaza, la question n’est plus “Pourquoi ?”, mais “Combien de temps avant la prochaine fois ?”.
Cette banalisation a un coût humain et moral considérable. Elle renforce le sentiment, chez les Palestiniens, que leur souffrance n’a pas la même valeur que celle d’autres peuples. Elle encourage l’impunité israélienne en confortant l’idée qu’aucune sanction ne viendra. Et elle affaiblit le droit international lui-même, transformé en simple rhétorique.
Depuis deux ans, Israël enseigne au monde ce que signifie le mot « capacité », au point de qualifier d’ores et déjà ce qui s’est passé dans la bande de Gaza de « génocide ». La condition sine qua non de la dépendance continue d’Israël à la force militaire : les milliards de dollars d’aide militaire annuelle des États-Unis. Si les États-Unis ont été un ami d’Israël, ils ont été un mauvais ami. Ils ont encouragé le pire chez les Israéliens, au détriment de son développement en tant que nation prospère et respectée. Le recours d’Israël à la force est bien connu. L’une des conséquences de ce recours quasi exclusif à la puissance militaire est un déclin marqué de la qualité de sa diplomatie. Israël insulte, ment, diabolise ou terrorise souvent ceux qui expriment des inquiétudes légitimes
La rhétorique de la “sécurité” comme arme politique
Le gouvernement israélien justifie ses actions par la nécessité de “neutraliser le Hamas” et de “sécuriser les citoyens israéliens”. Dans un communiqué récent, le Premier ministre a réaffirmé que “la guerre ne prendra pas fin tant que le Hamas ne sera pas totalement désarmé et que Gaza ne sera pas démilitarisée”.
Mais cette condition, impossible à atteindre sans destruction totale de l’enclave, condamne d’avance toute perspective de paix. Elle transforme un objectif politique — la survie d’Israël en guerre sans fin.
Le désarmement total d’un territoire assiégé et meurtri depuis plus de dix-sept ans est un mirage. Gaza n’est pas un État doté d’une armée classique, mais une société civile enfermée dans une prison à ciel ouvert, où la résistance — quelle qu’en soit la forme — devient une question de survie.
Sous cette rhétorique sécuritaire, l’opération militaire se mue en instrument de domination politique. Elle permet au pouvoir israélien de renforcer son contrôle sur les territoires palestiniens, de détourner l’attention de ses crises internes, et de maintenir une cohésion nationale autour de la peur.
Mais cette stratégie, répétée depuis des décennies, n’a apporté ni sécurité durable aux Israéliens, ni paix aux Palestiniens. Elle n’a produit qu’un enchaînement de guerres, de sièges, et de deuils.
L’aveuglement de la communauté internationale
Face à cette spirale, la communauté internationale persiste dans une prudence coupable. Les grandes puissances appellent à la “désescalade” tout en livrant des armes à Israël. Les institutions internationales condamnent du bout des lèvres les violations du droit humanitaire, sans jamais imposer de sanctions.
Quant à l’Union européenne, elle se réfugie dans une posture ambiguë, oscillant entre “préoccupation” et “solidarité avec Israël”, sans jamais reconnaître l’ampleur du désastre humanitaire.
Cette impuissance — ou ce refus d’agir — renforce le sentiment d’un deux poids, deux mesures dans la gestion des conflits mondiaux. Lorsque la Russie bombarde des civils en Ukraine, l’indignation est immédiate et unanime. Lorsque Israël fait de même à Gaza, les mots se font prudents, les condamnations se dissolvent dans le relativisme.
Cette incohérence n’est pas seulement politique : elle est morale. Elle décrédibilise le droit international, nourrit le ressentiment des peuples, et creuse un fossé entre les valeurs proclamées et les pratiques réelles des démocraties occidentales.
Briser le cycle de l’impunité
Reconnaître cette impunité n’est pas une posture partisane. C’est un devoir d’humanité.
Dénoncer les crimes de guerre commis à Gaza n’implique pas de nier la souffrance des Israéliens ni les atrocités du Hamas. Mais il faut cesser de placer les crimes des uns au service de la justification des autres.
Le droit humanitaire international est clair : aucune cause, si légitime soit-elle, ne justifie la punition collective d’une population civile.
Briser le cycle exige un changement radical :
- Mettre fin au blocus de Gaza, qui constitue une forme de siège permanent contraire à toutes les conventions internationales.
- Conditionner toute aide militaire à Israël au respect du droit international.
- Soutenir les mécanismes de justice internationale, y compris les enquêtes de la Cour pénale internationale sur les crimes de guerre commis des deux côtés.
- Et surtout, redonner une voix aux civils palestiniens, réduits au silence par la guerre et par le récit dominant qui les efface.
Redonner sens à la paix
La paix ne se construira pas sur les ruines. Elle ne se décrète pas par des communiqués diplomatiques ni par des trêves temporaires.
Elle exige une reconnaissance réciproque, une égalité de droits et la fin du système d’apartheid qui maintient les Palestiniens sous domination militaire.
Tant que la communauté internationale se refusera à nommer les choses — occupation, colonisation, blocus, punition collective — elle restera complice de l’injustice.
Le silence n’est pas neutre. L’inaction n’est pas prudence. Ce sont des choix politiques.
Et chaque jour de silence face à Gaza, chaque mot mesuré pour “ne pas froisser” Israël, contribue à prolonger une tragédie humaine qui pourrait être arrêtée.
Refuser cette impunité, c’est défendre un principe universel : la dignité humaine n’a pas de nationalité.
C’est rappeler que la sécurité d’un peuple ne peut pas reposer sur l’effacement d’un autre.
Et c’est affirmer, contre la fatalité, qu’une paix juste reste possible — à condition d’oser la vérité.
A/Kader Tahri
Chroniqueur engagé, observateur inquiet
« Il faut dire les choses comme elles sont, mais refuser qu’elles soient comme ça. »
https://kadertahri.blogspot.com/
Source : auteur
Notre dossier Palestine