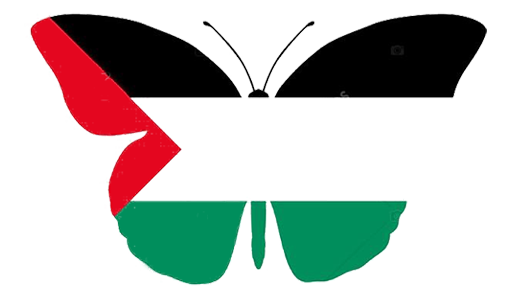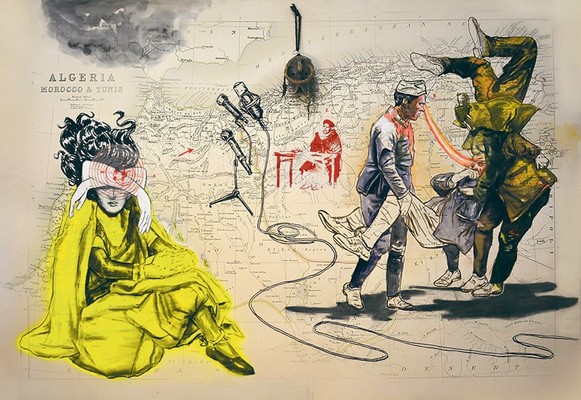Mohamed Lekleti. – « L’aube avait du plomb dans l’aile », 2022 © Mohamed Lekleti
Par Lahouari Addi
SIX ANS APRES LES PROTESTATIONS PACIFIQUES DE MASSE
Et l’armée algérienne défit le Hirak
Gardienne des institutions et du pouvoir depuis l’indépendance, l’Armée nationale et populaire (ANP) a su défendre le statu quo malgré la grande mobilisation de 2019. Après un éphémère printemps qui aurait pu déboucher sur une transition démocratique, l’heure est à la répression ciblée et au muselage des opposants. Mais les problèmes structurels, notamment économiques, demeurent.
Par Lahouari Addi *
L’Algérie a connu en février 2019 un véritable soulèvement populaire puis, pendant plus d’un an, des marches hebdomadaires pacifiques (1). Dès les premières semaines de ce qu’on nommera très vite « Hirak » (« mouvement »), les manifestants font reculer l’armée. Elle doit lâcher le président Abdelaziz Bouteflika qui brigue un cinquième mandat lors d’un scrutin prévu en avril 2019. Les décideurs militaires ne s’attendaient pas à une protestation d’une telle ampleur qui, au fil des semaines, radicalise ses slogans. Après quelques mois de flottement et de divergences palpables entre officiers supérieurs, la hiérarchie se ressaisit. Elle fait montre d’une solidarité de corps qui sauve le régime hérité de l’indépendance en 1962. En tant qu’il menace la prédominance de l’armée sur l’État, le Hirak impose de serrer les rangs. Les manifestants crient « État civil et non militaire » ou « les généraux à la poubelle ». Face à une telle défiance, l’unité devient indispensable. Mais il fait aussi donner des gages. Impliqués dans des affaires de corruption, une trentaine d’officiers supérieurs sont écroués dès les premières semaines de la contestation. L’armée entend le peuple, répète le chef d’état-major le général Gaïd Salah qui exige la démission de Bouteflika et ordonne la neutralisation de la ‘issaba (gang) en l’accusant d’avoir « fait main basse sur les finances de l’État ». Le très influent frère et conseiller du président, Saïd, deux anciens premiers ministres, dix-huit ministres et de nombreux députés et hommes d’affaires sont arrêtés et jugés pour détournement de fonds et corruption. On doit le souligner : à aucun moment, le Hirak n’est pris à partie par le discours officiel. Au contraire. Les dirigeants prétendent le protéger contre les islamistes et les berbéristes qui l’auraient infiltré. Il s’agit de montrer comment, grâce au « Hirak béni » – expression prisée par les dirigeants civils et militaires – le régime se purifierait. Le 19 février 2020, un décret présidentiel consacrera même le 22 février « Journée nationale de la fraternité entre le peuple et l’armée pour la démocratie ». Son article premier dispose que « ce jour commémore l’opportunité historique dans laquelle le peuple s’est exprimé le 22 février 2019 en solidarité avec l’armée sur ses aspirations à construire une nouvelle Algérie ».
À l’échelle de l’histoire du pays depuis son indépendance, le Hirak constitue un séisme politique. Il a provoqué l’effondrement de la façade civile du régime, mais sans libérer l’État de la tutelle de l’armée qui tient à demeurer la source du pouvoir en lieu et place du corps électoral. Au sein de l’appareil militaire, la contestation de cette prérogative a notamment suscité la crainte de devoir rendre des comptes au sujet des exactions massives commises lors du conflit entre forces de sécurité et insurgés islamistes dans les années 1990 (2) . Pour éviter la division, l’état-major a notamment fait le choix de réintégrer plusieurs généraux des services de sécurité limogés après l’assaut par un groupe armé du complexe gazier de Tiguentourine en 2013. À la suite de cette attaque au cours de laquelle trente-huit otages étrangers avaient trouvé la mort, le département du renseignement et de la sécurité (DRS) avait été scindé en trois services autonomes. Cela avait affaibli en pratique la surveillance de l’opposition. Et, six ans plus tard, en 2019, la hiérarchie militaire a dû réaliser que, sans police politique puissante, elle risque de perdre la main.
Un président sans charisme
À compter de l’été 2019, le général Gaid Salah appelle à la fin des marches au motif que les manifestants auraient été entendus (3). Il promet aussi l’organisation d’une élection présidentielle libre. Prévue le 4 juillet 2019, elle doit être reportée en raison de l’opposition toujours massive des manifestants. Les militaires choisissent alors d’attiser les clivages entre islamistes et non islamistes ainsi qu’entre arabophones et berbérophones. De fait, au fil des semaines, les marches hebdomadaires attirent moins de manifestants. Il redevient possible d’organiser une élection présidentielle en décembre 2019. Mais cela implique de choisir un candidat qui ne tenterait pas d’utiliser le Hirak pour s’imposer aux militaires.
M. Abdelmajid Tebboune fait alors figure de candidat idéal. Il a servi l’administration au poste de wali (préfet) puis de ministre de l’habitat avant d’exercer brièvement les fonctions de premier ministre en 2017. Surtout, il ne dispose pas du charisme qui permettrait de s’émanciper de la hiérarchie militaire. À peine élu avec un taux assez bas en comparaison des scrutins précédents, M. Tebboune se fixe l’objectif de réaliser les revendications du Hirak : la fin de la corruption et une plus grande liberté d’expression. Dans ses premiers discours, il 3 dresse même un bilan sombre de la période Bouteflika comme s’il n’avait jamais fait partie de son gouvernement. Avec M. Tebboune, les chefs de l’armée ont trouvé le président à l’ombre duquel s’abattra la répression, pour neutraliser les membres les plus actifs de la protestation. Dès décembre, le régime cible les noyaux durs du Hirak. Il prononce la dissolution de SOS Bab el Oued, association très active au sein du mouvement. Il modifie aussi le code pénal : ses dispositions criminalisent désormais l’opposition ; une demande de transformation du régime peut relever de la subversion terroriste. Le régime refuse ainsi toute perspective de changement, même suggérée par des militaires à la retraite comme le général Ali Ghediri. Après s’être déclaré candidat à l’élection présidentielle et avoir tenu un discours proche de celui de l’opposition, il a été condamné à plusieurs années de prison pour « atteinte au moral de l’armée ».
Depuis la fin du Hirak, dont les grandes marches ont aussi été empêchées par la pandémie du printemps 2020, le régime se durcit. Il a anéanti la relative autonomie de la presse et restreint les marges de manœuvre de l’opposition légale. La vocation des partis d’opposition consiste, selon les dirigeants, à accompagner le pouvoir exécutif. Dans cette perspective, les partis islamistes ont été neutralisés par la répression ou la cooptation tandis que le Front des forces socialistes (FFS) au discours sécularisé a dû rentrer dans les rangs après la mort de son fondateur Hocine Ait Ahmed au désespoir de sa base électorale. Renforcée, redéployée, la police politique surveille les réseaux sociaux et arrête des dizaines de personnes qui s’expriment sur l’état des libertés. Il y aurait près de 300 détenus d’opinion dans les prisons. Comparé à l’Égypte, qui en compte 6000, ce chiffre reste faible. De crainte de susciter un mécontentement général, la répression reste dissuasive. Elle cible des personnes susceptibles de faire des émules. Les militants les plus en vue comme Mme Mira Moknachi ou MM. Karim Tabou, Fethi Gherras, Brahim Lalami, Chouicha Kaddour, Said Boudour… sont soit en prison, soit régulièrement harcelés et menacés. Le jeune poète du Hirak, Mohamed Tadjadit, a été maintes fois arrêté, et récemment encore condamné à cinq de prison. Quant aux activistes installés à l’étranger, ils risquent une interdiction de quitter le territoire national au cas où ils se rendraient en Algérie pour des raisons familiales ou pour des vacances.
Très souvent, lors de cérémonies officielles sans rapport avec l’armée, M. Tebboune apparaît flanqué du chef d’état-major, le général Saïd Chengriha. L’une des caractéristiques du régime tient à ce que le président dépend de l’armée. Les décideurs militaires ont la main sur la confection du budget, tracent les grandes lignes de la politique étrangère.
Ils décident et les civils qu’ils cooptent servent de fusible en cas de mécontentement populaire. Ces officiers supérieurs n’ignorent pas les échecs économiques ou diplomatiques – enlisement de la question du Sahara occidental, hostilité croissante des États du Sahel…– mais les attribuent à des civils incapables oubliant qu’ils sont à l’origine des choix politiques.
Le régime a deux atouts : la solidarité de corps des officiers supérieurs et la rente pétrolière à laquelle ils sont très attentifs. Malgré les discours officiels sur l’après-pétrole, les gouvernements successifs ne parviennent pas à sortir de l’économie de rente à travers laquelle le régime contrôle la société (4). Le pouvoir tend à se scléroser. Il ne dispose ni de parti, où se concevraient les politiques économique et sociale, ni de clubs de réflexion animés par des universitaires qui éclaireraient les décisions stratégiques, ni de presse libre qui donnerait la parole aux citoyens. Insensible aux transformations de la société et aux évolutions géopolitiques, l’élite militaire demeure attachée à un modèle élaboré dans les années 1960 comme si le mur de Berlin ne s’était pas effondré, comme si le tiers-mondisme restait une grille pertinente de lecture des relations internationales. À défaut de base sociale, en l’absence de corps intermédiaires issus d’élections libres, le régime crée des clientèles qui lui servent de relais au sein de la société. Il importe aussi de vider les élections de leur sens politique. En pratique, l’administration désigne, à travers le bourrage des urnes, des « élus » qui ne contrarient pas la répartition de la rente pétrolière, ou qui contribuent à l’accumulation et la spéculation liée aux activités d’importation. Y compris le président. En septembre 2024, elle a reconduit M. Tebboune pour un second mandat avec score de 94,65%. Mais, malgré les ressources inépuisables de l’appareil étatique, le président n’arrive pas à établir le contact avec la population. Durant son premier mandat, il n’a visité que cinq wilayas (départements) dans un vaste pays qui en compte 58.
La situation économique demeure préoccupante. Le pouvoir d’achat des consommateurs continue de s’éroder du fait de la hausse des prix de la viande et des fruits et légumes. Les jeunes chômeurs sont aussi nombreux qu’il y a dix ans, les embarcations de fortune de l’émigration clandestine de plus en plus meurtrières. Les candidats à l’émigration paient 5 000 euros – une fortune dans le contexte algérien – pour prendre place dans une embarcation susceptible à tout moment de chavirer en pleine mer. Selon l’organisation Caminando Fronteras, plus de 500 jeunes algériens ont trouvé la mort en 2024 en cherchant à gagner les rivages de l’Espagne (5).
Grève des enseignants et des médecins
Malgré les conditions difficiles que vivent ses concitoyens, le président tient des discours apologétiques et vante la situation du pays. En décembre 2024, le mot- dièse « manich radi » (« je ne suis pas satisfait ») a trouvé un large écho sur les réseaux sociaux, relayés par des activistes que la police a arrêtés pour atteinte à l’ordre public. Malgré son caractère virtuel, cette protestation a suscité des craintes au sommet de l’État. Lors d’une réunion avec les walis, le président a même lâché : « L’Algérie ne peut être dévoré par un hashtag » (6).
Mais la contestation n’est pas que virtuelle. En janvier, des milliers de lycéens ont investi les rues des principales villes. Ils ont dénoncé des programmes scolaires surchargés et crié des slogans hostiles au gouvernement. Pour les soutenir, mais aussi pour obtenir des augmentations de salaire et l’amélioration des conditions de travail, leurs enseignants ont déclenché une grève à l’échelle nationale. Dans les hôpitaux, une mobilisation des médecins s’inscrit désormais dans la longue durée. Elle prend la forme de regroupements à l’intérieur des hôpitaux ou des facultés de médecine. Dès que les protestataires tentent de sortir dans la rue, des centaines de policiers mobilisés les répriment violemment. Les autorités craignent conflits sociaux sectoriels qui feraient tache d’huile et qu’il serait difficile de réprimer au prétexte de la lutte anti-terroriste.
Dépourvu de doctrine idéologique mobilisatrice, le régime fait le choix d’une surenchère nationaliste qui en reste au stade du discours – comme le montrent les crises récurrentes avec le gouvernement français (lire l’article de Lakhdar Benchiba). Ce système usé paraît incapable de s’adapter aux nouvelles réalités intérieures et extérieures. Il a raté une occasion historique, quand le Hirak invitait à une transition démocratique pacifique pour réarticuler l’Etat à la société et redonner à l’Algérie la place qui est la sienne dans le monde.
* Lahouari Addi est chercheur associé à Triangle, ENS, Lyon. Et professeur associé à l’Université du Maryland, Comté de Baltimore (UMBC). Dernier ouvrage La crise du discours religieux musulman. Le nécessaire passage de Platon à Kant, Presses universitaires de Louvain, 2022.
NOTES :
1. Lire Arezki Metref, « Hirak, le réveil du volcan algérien », Le Monde diplomatique, décembre 2019.
2. Lire « Dynamique infernale en Algérie », Le Monde diplomatique, octobre 1995.
3. Lire Akram Belkaïd, « Les louanges et la matraque », Horizons arabes, les blogs du « Diplo », 30 septembre 2020.
4. Vois les travaux de Samir Bellal, La Crise du régime rentier, éditions Frantz Fanon, Alger, 2017, et de Mourad Ouchichi, Les Fondements politiques de l’économie rentière en Algérie, éditions Déclic, Béjaïa, 2014.
5. Marlène Panara, « Sur la route migratoire entre l’Algérie et l’Espagne, une hausse effrayante des naufrages », 31 décembre 2024, www.infomigrants.nethttps://www.infomigrants.net/…/sur-la-route-migratoire… une-hausse-effrayante-des-naufrages
6. Makhlouf Mehenni, « Tebboune : “ L’Algérie ne peut être dévorée par un hashtag ” », 24 décembre 2025
Source : auteur
https://www.facebook.com/…
Notre dossier Algérie