(Image d’illustration) – © Darron Cummings Source: AP
Par Michel Raimbaud
Du 6 au 11 juin a eu lieu à le Sommet des Amériques. Habituellement marque de l’hégémonie des Etats-Unis, mais pas cette fois-ci. L’exclusion de Cuba, du Venezuela et du Nicaragua a empoisonné la suprématie étasunienne, appelant au boycott du Sommet.
Revenons un instant aux débuts d’une start-up nationpromise à l’avenir que l’on sait. Le 2 décembre 1823, le président Monroe présente au Congrès de Washington les principes de base de sa politique étrangère, résumée dans une formule lapidaire qui le rendra à jamais célèbre : «l’Amérique aux Américains».
Forts du succès de leur rébellion contre la couronne britannique, les dirigeants du jeune Etat fondé quarante ans plus tôt font manifestement peu de cas de la subtilité diplomatique et affectionnent déjà le franc-parler innocent et arrogant des pionniers du nouveau monde.
Certes, quand James Monroe parle de «l’Amérique»,il désigne sans conteste le double continent, mais qui sont ces «Américains» auxquels il se réfère ? Ses compatriotes, partis à la conquête sauvage d’un territoire sans frontières ? Ou tous ceux qui, de l’Alaska à la Terre de Feu, autochtones ou colons, «habitent » les Amériques ?
Force est de constater que le slogan conforte une ambiguïté propice à toutes les usurpations… celle précisément qui inspirera sous des dehors résolument hostiles au colonialisme européen l’impérialisme à tous crins des Etasuniens à l’égard de ce qu’ils perçoivent instinctivement comme leur arrière-cour ou leur espace vital. Pour ces occupants qui se sont émancipés d’un empire de la mer pour en créer un autre, l’Outremer c’est l’Europe. A ces descendants de migrants dont les ancêtres ont cru aborder aux Indes, inutile de demander de situer sur la carte Chine ou Russie. Ne forgent-ils pas alors, sans le savoir, les conflits, les ambitions et les injustices qui constitueront la toile de fond des sommets d’aujourd’hui ?
Le Sommet des Amériques qui vient de se tenir à Los Angeles du lundi 6 au samedi 11 juin 2022 n’est pas, comme on pourrait le croire, un grand raout annuel hérité de la doctrine Monroe. C’est seulement la neuvième édition d’une manifestation emblématique de l’hégémonisme de Washington, inaugurée en 1994 lorsque Bill Clinton avait réuni à Miami un Sommet panaméricain visant à mettre en place un grand accord de libre-échange. A la fois politique et économique, cette initiative s’inspirait peut-être de la tradition Monroe, mais elle s’inscrivait avant tout dans le cadre de la montée en puissance du «moment unipolaire américain» résultant lui-même du sabordage de l’URSS (en 1991).
Lire aussi : Le président du Mexique ne participera pas au «Sommet des Amériques» à Los Angeles
Quoi qu’il en soit, l’accord de libre-échange ne résistera pas face aux priorités politico-sécuritaires de «la guerre contre la terreur» lancée à la suite des attentats du 11 septembre. Il sombrera dans l’oubli dès 2005. Il semble bien que son enterrement sans cérémonie ait été lié à l’obsession de l’administration de Georges W. Bush pour le Grand Moyen-Orient et les intérêts d’Israël : sous l’influence de Dick Cheney et Donald Rumsfield, notre Dubia de sinistre mémoire procèdera en quelque sorte à un premier «pivot», négligeant un temps sa chasse gardée américaine pour s’acharner sur la «ceinture verte musulmane», c’est-à-dire la zone des ambitions sionistes et les périphéries de l’espace ex-soviétique. Dans cette perspective, même délestée de son espace impérial, la Russie était vouée à rester, hier comme aujourd’hui, une rivale redoutable qu’il faut abattre.
L’arrivée d’Obama aux affaires (en 2008) sera marquée par l’annonce d’un nouveau changement de cap, un deuxième pivot que les «experts» occidentaux, toujours à la traîne, s’empresseront de commenter avec gourmandise : dès lors que le Grand Moyen-Orient était censé perdre son importance stratégique, pourquoi ne pas l’abandonner à son chaos – créé par l’Occident – afin de se concentrer sur l’endiguement de la Chine, sacrée nouvel ennemi public numéro un.
Les évènements actuels, de l’Ukraine au Caucase et dans toute l’Asie Centrale, relativisent la validité accordée par les admirateurs de l’Oncle Sam à ses choix stratégiques. Si elle est déjà passée du statut d’ennemi à anéantir à celui d’Etat hors-la-loi, l’immense Russie reste un adversaire de choix, militairement, diplomatiquement et géopolitiquement. Elle est présente sur tous les champs d’opération, y compris ceux des Amériques, où elle s’est enhardie retournant (comme l’URSS de jadis) y narguer directement ou par alliés interposés «le plus puissant Empire que la terre ait jamais porté», celui qui a investi l’étranger proche de son ex-rivale lorsqu’elle était humiliée sinon impuissante.
En effet, les choses ne sont plus ce qu’elles étaient et les occasions ne manquent pas de le prouver, réveillant de mauvais souvenirs que l’Empire Atlantique croyait à jamais enterrés : certes, depuis trois décennies, l’URSS n’existe plus et soixante ans se sont écoulés depuis la crise de 1962, mais Cuba, restée amie de Moscou, n’a pas fini de payer l’affront infligé à son puissant et irascible voisin.
La Russie renaissante n’est pas pour rien dans le basculement constaté de l’équilibre mondial, même si elle n’est plus seule à incarner le «bloc eurasien». Bien que l’Occident, Etats-Unis en tête, s’escrime à en minimiser l’importance et le poids international, elle n’a pas été oubliée par le Sommet des Amériques, ne serait-ce qu’en creux : il est à remarquer que les trois pays exclus unilatéralement par Biden – Cuba, le Venezuela et le Nicaragua – sont trois alliés et partenaires, anciens ou non, de Moscou, et que leur absence a littéralement empoisonné l’atmosphère de la grand-messe hégémonique de l’Oncle Joe, provoquant une polémique majeure parmi les Latino-américains.
Les réflexions qui précèdent n’enlèvent rien à la percée remarquable de la République Populaire de Chine en Amérique Latine, et en conséquence dans les préoccupations de Washington. Propulsé en quelques décennies au sommet de la puissance, économique, financière, commerciale, militaire, technologique, au point d’être promu rival principal des Etats-Unis dans tous les domaines de la confrontation, le Céleste Empire, qui a les pieds sur terre, n’hésite plus à s’aventurer lui aussi sur les terres latino-américaines, toujours considérées par Washington comme un domaine réservé.
Le Sommet des Amériques a mis en lumière cette percée, l’un des points prioritaires de l’ordre du jour. Dans le cadre d’une activité diversifiée, la Chine a investi massivement dans les entreprises. Elle est impliquée dans des programmes de coopération, de financement, notamment en matière d’infrastructures. Contrairement aux Etats-Unis, plus prodigues en discours qu’en actes, la République Populaire s’avère prêteuse : depuis 2005, elle aurait avancé 150 milliards de dollars à l’Amérique Latine, dont la moitié au Venezuela, et sans conditions politiques. Ajoutons qu’en ces temps de Covid, loin de sanctionner, elle a donné beaucoup de vaccins. Cet engagement multiforme a porté ses fruits dans le domaine diplomatique et politique : l’Amérique Latine mise de plus en plus sur la République Populaire et oublie peu à peu Taiwan.
Pour Washington, pas question de choisir, il y a deux menaces convergentes : la Russie, que l’on affronte déjà en Ukraine, en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient, est redevenue une référence et un partenaire en Amérique Latine, tandis que la Chine y est également omniprésente, en qualité de deuxième partenaire commercial, voire premier concernant la seule Amérique du Sud.
Le IXe Sommet des Amériques est-il un succès ?
Du côté de Washington, on fait semblant de le croire, et on tient à le souligner (du bout des lèvres, car le cœur n’y est pas). Bien que l’on évoque une assistance «plus nombreuse qu’au précédent Sommet», tenu à Lima en 2018, il est visible que l’évènement, dont l’administration Biden attendait beaucoup, s’est soldé par un échec de taille, mettant en évidence les graves défaillances de la politique étasunienne vis-à-vis de l’Amérique Latine. Il n’est pas exagéré de parler d’un choc inattendu, qui a fait prendre conscience des mutations profondes intervenues dans la perception qu’ont les pays latino-américains de leur envahissant «grand frère».
Vieux cheval de retour, Biden voulait réaffirmer l’influence des Etats-Unis en Amérique Latine, en invitant à Los Angeles les chefs d’Etat à une grand-messe qui devait durer une semaine entière, et en les recevant avec le faste qui convient. En réalité, tenu dans une ambiance morose, revendicatrice, le dit Sommet semble avoir été frustrant. Les condamnations, plaintes, contestations, protestations n’ont cessé de créer et d’entretenir une impression générale d’échec, en contraste avec le «Sommet des Peuples» organisé, paraît-il, dans les mêmes parages et aux mêmes horaires, rassemblant un millier de représentants issus de plus de 200 organisations de la société civile.
L’ordre du jour fixé et brandi par Joe Biden lors de son discours inaugural n’avait rien de spécialement original, résumé par le slogan «Construire un avenir durable, résilient et équitable» : on annonçait le lancement d’un nouveau partenariat économique pour faire face à des défis tels que le changement climatique, la pauvreté, un accord sur la lutte contre le Covid 19… La délégation conduite par Biden s’est engagée à accroître la coopération dans tous ces domaines, y compris l’énergie pétrolière, les infrastructures sanitaires. L’oncle Joe n’a pas été avare en propos emphatiques et de circonstance : «les deux Amériques constituent la région la plus noble, la plus démocratique, la plus prospère, la plus sûre et la plus pacifique du monde» (sic). «Quoi qu’il arrive dans le monde, elles resteront en tête des priorités des Etats-Unis.»
Cependant, cette priorité claironnée par la présidence américaine ne pouvait satisfaire les Latino-américains tant elle est loin de leurs préoccupations majeures : les migrations illégales ou incontrôlées… Pour les pays voisins, tels que le Mexique, le sujet semble plus provocateur que prometteur. D’autant plus que le «guide du monde libre» ressuscité s’est montré au final et comme d’habitude bien pingre : bien que les dollars ne coûtent à «la puissance globale» que le prix de l’impression, beaucoup de promesses et de proclamations, mais peu ou pas d’engagements sonnants et trébuchants ou de mesures tangibles. Selon les commentateurs, Biden aurait montré de l’intérêt pour les affaires d’Amérique Latine, mais la modestie des engagements, apparue au grand jour, a souffert de la comparaison avec la pléthore des opportunités offertes par la Chine, dans le cadre de son offensive sur l’ex-chasse gardée. Et c’est là l’autre divergence fondamentale entre les Etats-Unis et leurs partenaires latinos : ce qui est tenu pour une menace majeure par les premiers est une opportunité irremplaçable pour les seconds…
En conséquence, une impression se dégage des péripéties qui ont agrémenté le Sommet. Tout s’est passé comme si l’enjeu ne portait pas vraiment sur l’ordre du jour ou les positions particulières des uns et des autres, mais plutôt sur les invitations lancées par Washington et le principe des exclusions, sur la représentation ou l’abstention des Etats, ou encore sur le niveau de représentation de ces Etats (le chef de l’Etat, le ministre des affaires étrangères, ou autre expédient). Comme le dira le Sénateur démocrate Tim Cayn, bon connaisseur des affaires latino-américaines, minimisant les multiples plaintes exprimées par les participants, qui selon lui font partie de la routine de ces rencontres régionales, «ce qui laisse une trace, c’est quand on dit que vous n’êtes pas là». C’est un bon observateur……
Alors que le Sommet est censé rassembler les chefs d’Etat des 35 pays membres de l’Organisation des Etats Américains (OEA), 23 seulement avaient été invités et ils n’ont été qu’une petite vingtaine à venir. Même si Biden a visiblement cherché à donner le change en conviant des présidents réputés «de gauche», comme le Chilien Gabriel Boric et l’Argentin Alberto Fernandez, c’est visiblement pour faire contrepoids au fasciste avéré qu’est le Brésilien Jair Bolsonaro : il convenait également de s’assurer les bonnes grâces d’un pays qui reste, toutes choses égales par ailleurs, membre des BRICS aux côtés de la Russie et de la Chine…
Les Etats-Unis n’avaient pas invité le Nicaragua, Cuba et le Venezuela, en raison de leurs réserves concernant «le manque d’espace démocratique» ou la question du «respect des droits de l’homme». En guise de protestation contre le fait que «tous les pays de l’Amérique n’avaient pas été invités», et en soulignant «la nécessité de changer la politique imposée depuis des siècles, à savoir l’exclusion», le Président du Mexique, Andrés Manuel Lopes Obrador, a créé l’évènement en boycottant purement et simplement la réunion. Autant on s’était accoutumé historiquement à voir dans Cuba une épine dans les relations avec l’Amérique Latine, autant le choc aura été profond concernant l’absence du Mexique, nombreux étant ceux qui ont souligné que ce boycott d’un sommet présidé par les Etats-Unis était totalement inimaginable auparavant, façon de dire qu’il créait un précédent.
Le Mexique était donc représenté par son ministre des affaires étrangères, Marcelo Ebrard – le Département d’Etat ayant fait contre mauvaise fortune bon cœur s’est dit «très heureux». Les présidents de l’Uruguay, du Salvador, du Guatemala, de la Bolivie étaient également absents, ainsi que la Présidente du Honduras, et les chefs d’Etat des Caraïbes, représentés par un ministre (Affaires étrangères ou autre). On notait la présence du Secrétaire Général de l’ONU et celui de l’OEA…
Encouragés ou portés par cette abstention significative, les dirigeants présents n’ont pas ménagé les critiques quant aux positions et pratiques des Etats-Unis, signifiant ainsi leur position commune à l’égard de la politique hégémonique de Washington sur la région latino-américaine, et aussi à propos des pressions constantes exercées sur Cuba depuis des décennies… Le président bolivien Lopez Arni Catacura, sa collègue du Honduras Ciumara Castro, le Chef de l’Etat argentin qui préside la CELAC, ou son collègue chilien ont mis l’accent sur les revendications relatives à la souveraineté des Etats et à leur droit à l’autodétermination. Tout s’est passé comme si les pays d’Amérique Latine ne supportaient plus les comportements du «Big Brother» tels qu’ils en ont fait l’expérience au long du siècle passé.
Il n’y a pas eu de déclaration finale. Ceci n’est pas vraiment une nouveauté mais a été interprété, dans les circonstances du moment, comme un aveu d’échec. Pour l’avenir, une chose est claire : les Etats latino-américains, partisans d’un dialogue ouvert et d’un multilatéralisme inclusif, ne se positionneront plus par rapport à un parrain américain en déclin, dès lors qu’ils disposent de plusieurs interlocuteurs ou partenaires de poids. L’influence des Etats-Unis décline, depuis deux décennies, et encore plus son magistère moral. Le Sommet des Amériques aura concrétisé et mis en lumière les mutations en cours dans l’ordre mondial, lançant un avertissement sévère aux Etats-Unis : ils ne feront plus la pluie et le beau temps. L’ère de leur domination, y compris et peut-être en premier lieu dans leur arrière-cour, est révolue. A chacun son «étranger proche»…
Mais peuvent-ils changer leur approche ? On peut en douter, de même que l’on peut douter de la capacité de l’Occident global à se remettre en question tant il est imbu de sa supériorité supposée, de sa «destinée» et de la conviction qu’il est à lui seul l’humanité. Seule la marche de l’Histoire, telle qu’elle se dessine actuellement, pourra lui faire entendre raison. Inch’Allah. Michel Raimbaud
Lire aussi : Sommet des Amériques : un «choc frontal» entre la vision mexicaine et américaine, selon Romain Migus
Michel Raimbaud est un ancien diplomate et essayiste qui a publié plusieurs ouvrages, notamment Tempête sur le Grand Moyen-Orient (2e édition 2017) et Les guerres de Syrie (2019).
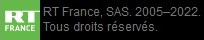
Source : RT France
https://francais.rt.com/opinions/…
Notre dossier États-Unis

